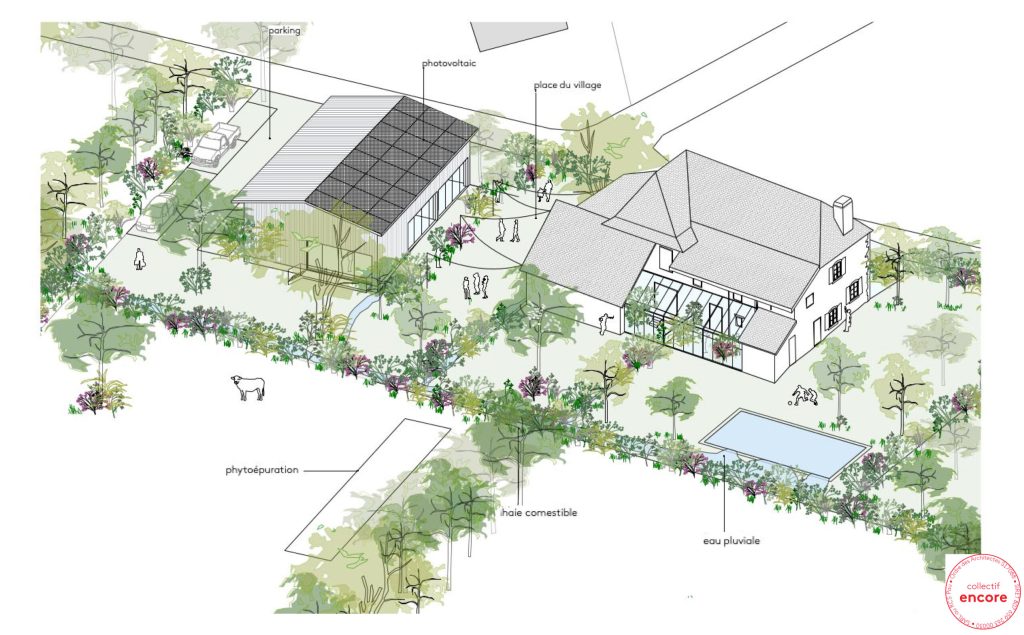Une situation d’urgence Les évolutions rapides qui affectent les régions gasconnes, dans le champ de la culture, des institutions, de l’économie, de la conscience d’identité en général risquent d’aboutir à la disparition pure et simple de la Gascogne en tant que réalité humaine vécue et fait historique connu. Des individus, groupes et associations cherchent certes à promouvoir la personnalité gasconne dans leurs domaines de prédilection : langue, musique, jeux, histoire, paysage, architecture, arts, économie, etc. Malheureusement leurs efforts se heurtent à deux sortes d’obstacles, dus à l’ignorance ou à l’indifférence :
Ce manifeste fait appel aux Gascons de bonne volonté réunis sur des principes communs, gages de meilleure écoute mutuelle et de projets réalistes. A. FONDEMENTSA1. On appelle Gascogne l’aire de la langue et du peuplement gascons définis par les linguistes, le « Triangle » fondateur approximativement bordé par les Pyrénées, l’océan Atlantique et la Garonne, limites géographiques qui ont façonné un espace de vie, créé une communauté de destin. A2. La Gascogne historique et humaine comprend : le Béarn, l’ancienne Généralité de Gascogne (moins le Labourd et la Basse-Navarre), la Guyenne gasconne (soit presque toute la Basse-Guyenne avec le Bordelais, ainsi que la Lomagne), des pays situés aux confins de ces régions majeures, dont le Val d’Aran. L’agglomération de Bayonne et le « Pays des Trois Vallées » au sud de l’Adour sont des points de rencontre des identités gasconne et basque. Aux limites de l’aire gasconne, de petits pays de langue saintongeaise ou des terroirs récemment dégasconnisés (notamment le Blayais), qui forment un point de rencontre des identités gasconne et poitevine-saintongeaise.  Carte de la Gascogne
A3. Langue, culture musicale et culinaire, jeux et divertissements aux multiples facettes et expressions locales, concourent à établir le fait gascon, en quelque sorte la gasconnité. Dans leur variété de terroirs, les aires agricoles, architecturales ou musicales constituent un vaste réseau de correspondances, un parcours diversifié. Loin de l’image d’un parcellaire démembré, il s’agit d’un tissu humain cohérent et interactif, alliant montagne et plaine, pays d’élevage et pays viticole, mer et collines. C’est cet organisme intégré que nous devons maintenir et renouveler. A4. On est en droit de parler de peuple gascon entendu comme groupe humain fondé sur des critères objectifs et une conscience d’appartenance suffisante. A5. La spécificité des Gascons est le résultat de l’appartenance de leurs ancêtres et prédecesseurs sur les mêmes territoires à plusieurs ensembles humains et historiques succcessifs qu’ils ont contribué à façonner :
Les Gascons ne sont donc pas des « Méridionaux ». La Gascogne n’est ni « le Midi » ni « le Sud », étiquettes relatives. A6. L’histoire a divisé le territoire gascon. Le fait ethnique basco-roman s’est poursuivi dans le fait ethno-linguistique gascon, assis sur une relative unité géographique et une stabilité bi- voire plurimillénaire. La Vasconie puis la Gascogne des Ducs ont traduit administrativement cette identité populaire pendant plus de quatre siècles. L’histoire s’est ensuite déroulée dans des cadres temporels fluctuants mais souvent identifiables comme gascons. Des tendances centrifuges ont mené à l’émancipation de petites entités gasconnes (Béarn, Bigorre, etc.), jusqu’à l’éclatement administratif actuel de l’espace gascon, parallèlement attiré par des espaces aquitain puis français. L’histoire des Gascons traduit les tensions internes et les sollicitations d’un peuple qui n’a jamais disparu. A7. L’entrée de la grande majorité des pays gascons dans l’État français (Val d’Aran excepté) s’est faite à des époques différentes et suivant des modalités diverses.  La Gascogne écartelée entre deux régions
Les Aranais gascons sont citoyens espagnols, inclus dans la Généralité de Catalogne. Ils ont un statut particulier, dont le respect de la langue officielle (dénommée « occitan aranais ») est un élément constitutif. A8. Le nom des Gascons est un autonyme, c’est-à-dire leur nom indigène, dont l’étymologie est commune avec le nom que se donnent les Basques. Ce nom provient d’une racine *eusk- qui se retrouve dans la forme latine Uascones. Le nom de Vasconie, Vasconia, s’applique aux territoires issus de la matrice ethno-linguistique paléo-basque de l’Antiquité. A9. La langue gasconne est l’un des critères majeurs de l’identité gasconne. A10. Le gascon n’est pas un dialecte mais une langue aquitano-romane de la famille d’Oc ("occitane" dans un sens général). Il se trouve au point de rencontre de trois aires linguistiques de l’Europe du Sud-Ouest : l’aire sud-occitane, l’aire bascophone, l’aire hispanophone. Il est aussi inclus, suivant d’autres modalités, dans l’aire de la langue française, d’usage actuellement très dominant dans l’aire gasconne et les territoires voisins au nord des Pyrénées. A11. Comme toute langue vivante le gascon possède des dialectes et des parlers. A12. La distinction entre « béarnais » et « gascon » est liée à une assimilation abusive, mais culturellement explicable, entre les aires linguistiques et les entités historiques. Les distinguer comme deux langues est une erreur, le béarnais étant traversé des mêmes variations que les autres régions gasconnes. « Béarnais » ou « landais » indiquent seulement le lieu des parlers gascons considérés, non leurs caractéristiques intrinsèques. A13. Les appellations « occitan du Béarn », « occitan de Bigorre » (ou d’autres régions gasconnes) sont trompeuses. Elles relèvent d’un occitanisme centraliste, parfois « jacobin », aux conceptions linguistiques, culturelles et historiques réductrices et erronées. « Occitan gascon » représente l’appartenance à une famille plus large mais reste ambigu, « occitan » tout seul est inadmissible en pays gascon. A14. Au cours de sa longue histoire, le gascon a connu plusieurs graphies ou codes. Rappelons que la graphie d’une langue est une convention qui supporte des compromis, des héritages et des innovations, aucun système n’étant parfait en soi. Une langue est d’abord parlée. A15. L’état présent de la Gascogne et des Gascons est l’aboutissement de mutations profondes qui se sont affirmées au XIXe siècle et accélérées au XXe. Il se caractérise en particulier par : la fin de la société traditionnelle-rurale ; la quasi-disparition de la langue gasconne devant le français ; des mouvements migratoires intenses ; l’urbanisation. A16. Aujourd’hui la gasconnité est contrariée, déviée ou occultée par plusieurs facteurs :
| Une histoire à continuerA17. Les ressources de la Gascogne sont sous-estimées. Les Gascons doivent retrouver leur propre centralité, faire preuve d’audace et de sens des réalités. La Gascogne ne se fera pas « contre » ses détracteurs de tous bords (jacobins français, jacobins occitans, indifférents ou négateurs), mais « pour » ses habitants, et « avec » ceux qui s’y reconnaissent. A18. La Gascogne, qui constitue une réalité humaine et géographique aussi solide que la Provence, la Lorraine, la Galice ou la Bourgogne, n’a aucune raison d’accepter d’être rayée de la carte. Elle peut redevenir au troisième millénaire un espace cohérent et clairement identifié, en France, en Europe, et même dans le monde. Les Gascons y ont un intérêt vital, affectif, mais aussi matériel et économique. A19. La distribution des pays et les solidarités locales, les relations commerciales et humaines maintenues en dépit des forces centrifuges, révèlent des solidarités fondamentales qui devraient être réactivées dans des « pays de programmes » ou tous autres cadres institutionnels à venir. L’AMBITION GASCONNE A20. L’idée gasconne est de donner forme au sentiment gascon, à la gasconnité vécue, expression du fait gascon, pour le faire accéder à sa pleine réalisation. Cette ambition est fédératrice. La Gascogne est un horizon identitaire, ce que révèle la permanence d’un attachement au « Sud-Ouest », expression populaire qui n’est cependant pas toujours pertinente. (« Sud-Ouest » est un peu plus large que la grande Gascogne. Le pays toulousain, le Périgord, le Quercy, y sont communément inclus, alors qu’ils ne sont pas ou peu gascons.) A21. Les Gascons doivent affirmer leur personnalité par l’usage des couleurs blanc et rouge et d’emblèmes communs à tous (drapeaux au sautoir blanc sur fond rouge ou bien au tranché rouge et blanc ; croix de Gascogne d’or bourgeonnée et flamboyante ; effigie dite la Daune). A22. On ne défend une identité menacée qu’en l’illustrant. La tentation du repli doit faire place à la volonté de reconstruction dans un esprit d’ouverture, de discussion et de concorde. La situation d’urgence actuelle l’exige, sans cesser d’être à la hauteur de l’histoire plurimillénaire de la Gascogne. A23. Les efforts sincères d’enseignement de la langue des pays gascons doivent être restitués à leur cadre naturel et authentique : celui de la culture gasconne et de la Gascogne. Beaucoup de préjugés et de fausses querelles tomberont de ce fait. B. ENGAGEMENTSB1. Il est urgent de faire naître une perspective qui mette en correspondance dynamique tous les éléments de la vie gasconne. B2. Nous appelons à la mobilisation des forces vives de la Gascogne, par-delà leurs différences, sur des objectifs communs qui devraient faire l’objet d’un consensus. B3. Nous appelons au réveil des consciences des Gascons face à l’arasement de leur culture. B4. Il est impératif de répondre à la demande d’identité et de gasconnité qui se manifeste aujourd’hui à maints égards en pays gascons , de façon parfois maladroite voire un peu désespérée. B5. Une des conditions du réveil est de mettre un nom sur la gasconnité vécue, spontanée, qui affleure encore. Ce qui n’est pas nommé est comme s’il n’existait pas. Osons nommer la Gascogne et les Gascons. B6. Il est primordial de mettre en valeur ce qui existe déjà dans tous les domaines : noms de lieux, arts, architecture, paysage, cuisine, productions agricoles et industrielles... B7. Sauver ce qui peut l’être du patrimoine linguistique gascon, l’actualiser et le transmettre, exige la tolérance et la réflexion commune sur la langue, et notamment sur la langue parlée. Dans cette perspective les sectarismes de tout bord et les querelles de personnes sont hautement nuisibles. B8. Il est nécessaire de lier l’idée gasconne et la langue aux activités gasconnes et en Gascogne, de toute sorte, autant que cela est possible, dans tous les milieux sociaux et professionnels :
B9. Il est urgent de repenser et de réformer la fête gasconne (la Heste), même au prix d’une remise en cause radicale des manifestations de masse qu’elle a produites ces dernières années. La fête est l’expression d’une convivialité propre au groupe qui la fait.  Musica hestiva
B10. Le chant et notamment la polyphonie dans l’esprit de ce qui est maintenant nommé cantèra sont très importants, comme les hestes. Le chant articule convivialité, création, et reste un lieu d’usage du gascon. B11. Un moyen de réduire la fracture des générations est d’organiser des « Cercles de Parole » qui transmettront tout ce qui peut encore l’être de la culture orale, dont le chant est une expression majeure. B12. Il est nécessaire d’ancrer les jeunes dans nos pays. Même s’ils font désormais souvent un tour d’Europe ou un tour du monde, il serait bon que beaucoup reviennent ensuite ; et aussi que les « nouveaux Gascons » qu’on peut dire « de sol » soient séduits au point de se rallier à l’idée gasconne. B13. L’action signalétique est très importante : Comme les noms de famille ou les prénoms, les noms de lieux sont une part de cet héritage immatériel qui relie les générations et fonde les appartenances.  La Romieu - L’Arromiu
Il y en a des centaines à faire comme ça...
Pour les amateurs, j’ai utilisé pour celui-ci, avec le logiciel GIMP, la police Utopia taille 62 pour les grands caractères et Utopia Italique 27 pour les petits. Tederic M.
En matière de panneaux toponymiques il y a des degrés d’urgence et de pertinence. On sera particulièrement attentifs au choix des nouveaux noms de lieux (lotissements, etc.) qui donnent leur visage parlant aux communes. On relèvera donc les noms anciens de parcelles, voies, propriétaires. On signalera les noms des anciens quartiers. B14. On sera vigilant sur l’aménagement de l’espace public où sévit maintenant la dénaturation des sites : pas de constructions en ligne de crête, pas de « mitage » du paysage, respect de l’architecture locale (vernaculaire), reboisement à long terme, entretien aussi du patrimoine, en commençant par le plus modeste (fontaines, mobilier funéraire, bornes, croix, etc., tout ce qui sans être « classé » ou inventorié traduit des normes culturelles autochtones). B15. On favorisera les produits du pays. Produire et consommer local est recommandable tant par solidarité avec les producteurs locaux que pour limiter les pollutions et nuisances dues au trafic routier massif. Les circuits de distribution courts sont une chance pour nos pays gascons de se refaire, et de diminuer l’hypermobilité de la population et l’exil des jeunes actifs. B16. Dans le mouvement actuel de la mondialisation et de la construction européenne, la protection et la promotion de l’espace gascon exigent qu’on valorise et revitalise ce qui est perçu comme local, aujourd’hui trop souvent présenté comme hors de l’histoire, de l’innovation, de la création, synonyme d’impasse, d’ennui pour la jeunesse et de mouroir pour nos anciens. B17. Un des moyens envisageables pour faciliter ces progrès est la création d’une région administrative correspondant au territoire gascon. C. APPELTous les gascons sincères sont invités à prendre en compte les idées exposées ci-dessus, à les commenter, à les diffuser, à y puiser, à s’en inspirer dans leurs activités, à se montrer attentifs aux propositions de ceux qui les partageraient quand bien même ils seraient en désaccord avec eux sur d’autres sujets ; à réfléchir aux orientations que pourraient prendre les actions culturelle, linguistique, artistique, sociale pour que revienne enfin au centre du discours et de l’activité la conscience d’appartenance gasconne. Les auteurs de ce manifeste invitent celles et ceux qui en partagent l’orientation générale, même s’ils sont en désaccord sur des points secondaires, à y adhérer. Il ne s’agit pas d’une pétition. Les signatures sont publiques, et peuvent mentionner la qualité du signataire. Vous pouvez, en utilisant la fonction "Répondre à cet article", apposer votre signature au Manifeste gascon, tout en le commentant. |

Le Manifeste gascon Version 1